→ De l’art comme métaphysique — « Je n’oublie pas non plus que j’ai, dans ce même roman, comparé l’art à l’inoculation d’une expérience. Quelque chose qui, sans avoir été vécu, peut être éprouvé. Quelque chose d’irréel, devenu pourtant accessible à la sensation. C’est dans certaines œuvres, à présent, que je cherche la vie, la vraie. » (Jakuta Alik Ava Zovic, NRF, La zone spectrale, pp. 56-57)
→ Gegenwort, ou de la possibilité de la poésie après Auschwitz — « Leçon apprise chez Celan qui ne se résout pas à taire l’horreur, à s’aligner sur l’injonction d’Adorno, selon laquelle « il ne peut plus y avoir de poésie après Auschwitz ». À cette affirmation sans relève, sans espoir, sans promesse d’une ouverture par où passe la vie comme survie, Celan répond par la Gegenwort, à savoir une contre-parole ; une langue témoin qui dit le traumatisme, le désespoir, la mort dans les chambres à gaz, le silence de Dieu et des hommes. Que la poésie puisse être encore, après Auschwitz, le lieu d’une idéalité romantique, plus idéelle que la littérature et la philosophie, voilà bien le mensonge métaphysique auquel Celan entend mettre fin. Non, la poésie ne dit pas que le sublime. La poésie est traversée par les traumatismes, en l’occurrence le traumatisme de la Shoah. Il s’agit donc pour Celan d’écrire dans l’envers même de ce qui fit les grandes heures de la poésie romantique allemande, par-devers des significations héroïques privées de lumière et d’éclat. La poésie est le lieu où l’utopie humaniste issue des Lumières s’est définitivement brisée. Dire l’irréparable et l’innommable, tel est le projet que porte Celan en son for intérieur. » (Le monde n’est plus. La poésie de Paul Celan à l’épreuve, DE Daniel Cohen-Levinas, NRF, MAI 2021, p .60). Celan le résume en une phrase dans « Le méridien » : « La poésie, Mesdames et Messieurs – : cette parole qui recueille l’infini là où n’arrivent que du mortel et du pour rien. » (p. 62). Daniel Cohen-Levinas conclue : « Lire la poésie de Celan en temps de pandémie est une manière d’écouter dans cette contre-parole un reste de désir, plus fort que la contamination, plus fort que la mort : un désir de survie. » (p. 64)
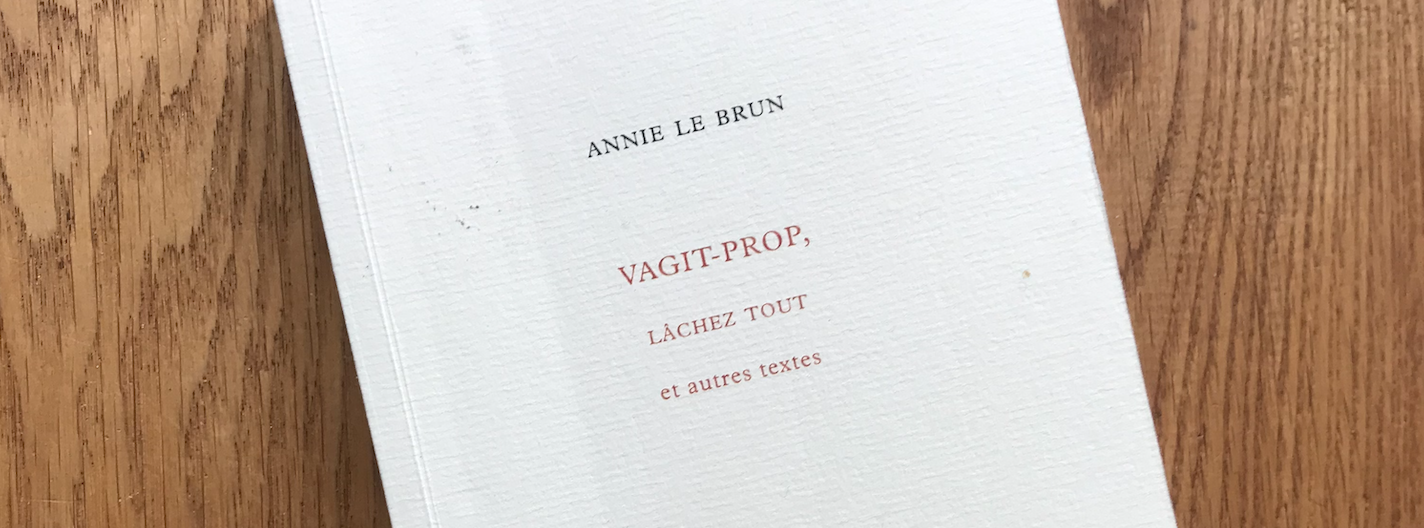
→ Le néoféminisme, cette plaie — Je relie l'introduction qu'Annie Le Brun donna à la réédition de son Vagit-prop. Quelques extraits : complice de la marchandisation du monde sensible, « le néoféminisme a servi tout à la fois d’adjuvant et de couverture idéologique à l’entreprise d’expropriation du sujet inaugurée par la société industrielle de ces années-là » (pp. 7-8). « Et cela jusqu’à circonvenir les dernières traces d’une révolte des femmes en octroyant à celles-ci une indéniable liberté de consommateurs et, du même coup, en les accoutumant à tout en attendre » (p. 9). « Entre liberté et tolérance, l’idéologie néoféministe aura essentiellement eu une fonction de formatage, visant à ce que la majorité des femmes participe de ce nouveau type d’aliénation » (p. 8). D'où la violence de ses textes — une violence, précise-t-elle, « à la mesure de ce que j’étais en train de voir disparaitre avec l’ampleur des grandes épidémie de servitude volontaire, dont l’humanité est périodiquement affectée » (p. 7). Elle conclue par une interrogation : « Mais que dire des néoféministes qui auront appris à gravir les échelons du pouvoir au gré de leurs liftings ? Que dire de leur constant effort pour dépassionner la vie ? [cf. Badinder qui, dans son ardeur à vouloir absolument l'« éradication du désir », se félicitait que « la passion est en voie d’extinction, le vestige sensuel aussi »] Sinon que tout se tient et que leur «pragmatisme» est le nouveau maquillage dont se pare la servitude volontaire. Mais aussi qu’il est grand temps de regarder ailleurs et autrement, et surtout qu’il est encore et toujours temps de déserter. » (p. 13)

→ De Hegel à Marx, de Jacques d’Hondt — De la désacralisation de l’art : « L’artiste n’est pas « indépendant du temps et des circonstances ». Au contraire, il est leur porte-parole, et Hegel le précisera : « Tout individu est fils de son temps » ! Dans ces conditions, nous confie Forster, « les figures grecques et les dieux grecs (...) nous sont devenus aussi étrangers que des sons et des noms prononcés en grec dans notre poésie » (p. 45). « Pour Hegel, l’art, après la période grecque, ne joue[-t-il] plus qu’un rôle subordonné. La religion se sert de lui dans un but d’édification, les individus y cherchent une distraction. C’est en cette dégradation que consiste la mort de l’art. Il peut bien se perfectionner encore formellement, mais il ne regagnera jamais plus sa dignité d’antan » (p. 44). « Les œuvres perdent leur signification quand disparaît la base spirituelle sur laquelle elles se fondaient. Ce qui, après transposition, se comprend assez bien aussi dans la perspective marxiste : l’art change avec ses conditions sociales. La base entraîne dans sa ruine la « superstructure » qu’elle portait. Forster, Hegel et Marx sont donc d’accord sur ce point capital : l’art grec a disparu, et les conditions, spirituelles et politiques pour Forster et Hegel, matérielles et sociales pour Marx, dans lesquelles il prospérait, ne reparaîtront plus jamais » (p. 46). Cela ne signifie pas pour autant que nous ne puissions pas « goûter encore celles que les Grecs créèrent et qui subsistent » (p. 46) : « il y a deux manières de saisir le passé, et en particulier l’art passé. On peut d’abord regarder de l’extérieur les objets du passé, dépourvus d’esprit et étrangers à notre pensée actuelle, des cadavres. C’est l’attitude dogmatique. Mais on peut aussi les comprendre, en retrouvant dans une certaine mesure leur esprit, ou en les dotant d’une signification actuelle projetée sur le passé, discerner en eux l’expression d’un moment du développement sans lequel nous ne serions pas ce que nous sommes, et le reconnaître en nous comme on reconnaît une réminiscence de l’enfance. Alors, identifiant en eux l’expression d’un moment dépassé de nous-mêmes, nous les réintégrons à notre personnalité, nous les assimilons, et ainsi nous leur donnons une nouvelle vie en nous » (p. 47). Hegel prône ainsi « l’assimilation, l’accueil intelligent et compréhensif d’un héritage culturel qui constitue comme une partie de nous-mêmes : le genre humain est ce qu’il est devenu, et l’art, en cheminant, emporte toujours avec soi son passé » (p. 48). D'où la nécessité d’assimiler les « œuvres antiques, considérées comme « la meilleure nourriture » pour l’esprit et en même temps comme une occasion éminente d’éprouver l’étrangeté » (p. 48).
→ La critique d'art, une définition possible — « Forster s’abstient de décrire méthodiquement chaque œuvre d’art singulière. Il préfère communiquer les impressions qu’il a ressenties devant elle : « A mon avis, on atteint mieux son but en racontant ce que l’on a ressenti et pensé devant une œuvre d’art, et donc en disant l’effet qu’elle a produit, et comment elle l’a produit — plutôt qu’en la décrivant en détail » (p. 52)
→ Du classique au romantique, changement de paradigme — « Hegel explique, à sa manière, que « la beauté classique doit, dans ses expressions, se tenir éloignée du sublime », alors que le gothique reçoit l’autorisation de « faire franchir à l’âme les bornes de l’entendement ». Le classique recueille toute la beauté du monde. Le romantique, par contre, nous déracine et nous tourne vers l’au-delà. La cathédrale nous prépare au grand dépaysement. Dans le monde, nous nous y déprenons de ce monde. Forster dessine le contraste : « Les figures grecques semblent se rattacher à tout ce qui est là, à tout ce qui est humain ; les formes gothiques existent comme des apparitions d’un autre monde, comme des palais féeriques, pour donner témoignage de la puissance créatrice de l’homme, qui sait poursuivre jusqu’au bout une idée isolée et atteindre le sublime même par un chemin excentrique. » (p. 56)
→ L’art chrétien, herméneutique parcellaire et indigente — « Ils auraient aimé les paroles heureuses que M. Dufrenne choisit pour nous mieux faire goûter l’essence du poétique : « Une tendresse en nous qui répond à une tendresse des choses », et cette confiance « à la fois dans la générosité et dans la bienveillance du sensible ». Car pour eux l’art s’enchante du sensible. Or, si l’art grec idéalise le sensible pour y former ses dieux, le christianisme, lui, crucifie le sensible, le malmène sans tendresse. Lorsque l’âme s’arrache au sensible, elle se détourne aussi de l’art. Hegel désigne l’antiquité grecque et le haut Moyen Age comme les deux périodes favorables à l’art, conjointement révolues, perdues toutes deux à jamais. Elles ne s’équivalent cependant pas : l’une fut un bel épanouissement, et l’autre une belle agonie. L’art est toujours sacré. Grec ou chrétien, il consiste en « une herméneutique des forces spirituelles », pour employer une expression de Forster. Or l’art grec réalise une herméneutique intégrale et parfaite, tandis que l’art chrétien n’aboutit qu’à une herméneutique parcellaire et indigente. » (pp. 57-58). En effet, « l’irruption du négatif [l'art ayant désormais pour « tache d’illustrer une religion de l’individualité, de l’inquiétude, de la souffrance et du malheur » (p. 58)], qui annonce la religion plus humaine et plus intérieure, ne favorise pas un art plus pur. » Cependant, Hegel, s'il regrette la religion nouvelle car « elle provoque un déclin de l’art » (pp. 59-60), il l'approuve car elle marque un progrès de l’esprit humain. Jacques d'Hondt relativise ce « déclin » : « Hegel doit bien se rendre compte qu’en interdisant le péché et la sainteté, qu’en exorcisant le mal et la souffrance, il restaure la pureté esthétique, mais aussi l’innocence de l’art grec, « qui ignore le péché et le mal » ! Sa Madeleine, belle âme dans un corps si beau, est une sœur de Diane et de Vénus, mais devenue songeuse, et plus touchante à travers ses larmes » (pp. 63-64).
→ Si « l’art est une objectivation de l’esprit », « les sujets que choisit un artiste, ou qu’on lui impose, le jugent, ou jugent son époque » (p. 61) — Par exemple, « la religion grecque supposait, comme l’avait vu Forster, une fusion singulière de la conscience religieuse et de la conscience esthétique : « Il y eut une concordance heureuse entre l’idée de l’art et le système religieux de ces peuples, de telle sorte qu’on éleva le modèle de la beauté et de la perfection surhumaines en objet d’adoration » (A, I, 208). Hegel commente : « Le peuple grec a pris conscience de sa spiritualité en donnant à ses dieux des formes concrètes, sensibles, en en faisant des objets d’intuition et de perception, en les dotant d’une existence parfaitement adéquate au contenu véritable. C’est grâce à cette adéquation, à cette correspondance, incluse dans le concept de l’art grec aussi bien que dans celui de la mythologie grecque, que l’art a pu devenir en Grèce la plus haute expression de l’absolu, et la religion grecque celle de l’art même » (p. 72). Ensuite, comme le précise Forster « dans un texte que Hegel transcrivit, les hommes se détachèrent des dieux grecs, si beaux, mais trop grands pour eux, afin de rechercher un dieu qui leur fût encore plus proche, souffrant comme eux, pâtissant avec eux » (pp. 58-59). « L’art romantique, tout en étant un art, révèle déjà une forme de conscience plus élevée que celle que l’art en général est capable de traduire ». Mais « la vue de la beauté lasse la grande masse des artistes et des amateurs, qui ne plient plus le genou devant elle, ne l’adorent plus et n’implorent plus sa protection et ses présents » (p. 72). « Nous nous enfonçons désormais dans la prose de la vie » (p. 73).
→ Chaque peuple, dans les conditions historiques qu’il subit, modèle des dieux qui lui conviennent : « nous créons des dieux à notre image ». La doctrine du Dieu-Miroir (« La puissance absolue, quelle que soit la figure extérieure qui la recueille, ne jaillit jamais que de l’esprit humain. » p. 104) — Les « hommes désespérés imaginent un Dieu qui leur ressemble, s’accorde à leur faiblesse, et les console. » Cette « projection hors de soi » engendrera un Dieu étranger à celui qui le crée inconsciemment. Hegel parle d’aliénation (entfremdung). Mais « Hegel ne l’isolera pas abstraitement. Il la rattachera aux conditions historiques. La religion chrétienne, par exemple, naît dans une situation politique qui rend l’aliénation religieuse inéluctable : « Le despotisme des princes de Rome avait chassé l’esprit de l’homme de la surface de la terre ; le rapt de sa liberté avait contraint l’homme à abriter son éternel, son absolu, dans la divinité ; la misère que ce despotisme répandait l’avait contraint à chercher et à attendre le bonheur au ciel. L’objectivité de la divinité est allée de pair avec la corruption et l’esclavage de l’homme, et elle n’est à proprement parler qu’une manifestation, qu’un phénomène de cet esprit de l’époque » » (pp. 101-102). Jacques d'Hondt fait remarquer à juste titre que Lénine ignorait les formules du jeune Hegel qui définissent un Dieu-Miroir, il n’avait pas en main ces cours d’Iéna dans lesquels Hegel prétend que « la nature humaine ne diffère pas de la nature divine ». Pourtant, Engels avait évoqué, sans aucune réserve, ce « principe fondamental » de Hegel : « Humanité et divinité, du point de vue de l’essence, sont identiques » (pp. 103-104). Il ajoutera même : « La critique du christianisme par Feuerbach est un complément de la théorie spéculative de la religion fondée par Hegel » (p. 105). N'est-ce pas Hegel, en effet, qui est l'auteur de ces formules très feuerbachiennes : « Ce fut un mérite réservé à notre temps que de revendiquer comme propriété de l’homme, du moins en théorie, les trésors qui ont été gaspillés aux cieux. Mais quel est le siècle qui aura la force de faire valoir pratiquement ce droit et de s’assurer de cette propriété ? » (p. 102) ? Un tel siècle, répondront Marx et Engels, sera celui d'une société débarrassée de l'exploitation et des classes ; celui qui verra l'avènement du communisme.
→ « L’orientation de l’histoire ne dépend pas des bons sentiments » (p. 141) — « La « justice », l’« humanité », la « liberté », etc., peuvent demander mille fois ceci ou cela ; mais si la chose est impossible, alors elle ne se produit pas et elle reste malgré tout cela une chimère (...). Avec tous les vœux pieux et les beaux rêves, on ne peut rien faire contre la nécessité » (p. 158). « L’individu qui prétend agir pour des fins si nobles et a sur les lèvres de telles phrases excellentes passe, à ses propres yeux, pour un être excellent, il se gonfle et gonfle sa tête et celle des autres, mais c’est une boursouflure vide » (p. 143). « Ainsi échouent l’action directe, le remue-ménage anarchiste paré de belles phrases, l’opération individuelle, le déchaînement de passion qui ne tient nul compte de la réalité et de ses lois et qui, sous des prétextes prestigieux, ne vise finalement que des buts personnels, une vengeance individuelle qu’exerce sur la société un personnage qui se croit exceptionnellement lésé par elle et exceptionnellement supérieur à elle. Présomptueux, ceux qui prétendent infléchir le cours du monde au gré des élans confus de leur cœur ! Ils échoueront — mais non sans avoir causé des souffrances et des ruines inutiles » (p. 143). « Tant que les gens rêvent, le désordre établi n’a rien à craindre » (p. 221).
→ Camarade Hegel — « Voilà le mal que Hegel veut guérir. Il désire que l’homme ne vive plus comme un étranger sur cette Terre, qu’il n’ait plus le sentiment de recevoir les ordres d’un maître étranger, comme un esclave — que ce maître se trouve hors de lui ou en lui. Hegel souhaite que l’homme se sente « chez lui » dans le monde, c’est-à-dire qu’il se sente libre » (p. 144).
→ L'hégélianisme est un anti-gauchisme — Mais « la réconciliation de l’individu et de la réalité sociale n’exclut-elle pas la transformation de cette réalité sociale, ne supprime-t-elle pas les conditions nécessaires de l’évolution et, a fortiori, de la révolution ? » (p. 153). La conversion au réel n’implique-t-elle pas forcément « une adhésion au conservatisme » (p. 154) ? Non, car « il n’est pas certain qu’une philosophie révolutionnaire doive être « négative par rapport au monde » : « Sur tous ces points, la plupart des grands révolutionnaires furent de grands conformistes : ils ne cherchèrent pas à se distinguer et à se séparer de leur peuple, mais au contraire ils voulurent vivre sa vie. Aussi s’accommodèrent-ils souvent très passivement des mœurs que leur imposait leur milieu. Le révolutionnaire est monogame dans un pays monogamique, il porte les vêtements usuels, se nourrit des aliments habituels, mène une vie « rangée », parle le langage de tous, ne se « singularise » pas. Ses préoccupations fondamentales sont d’un autre ordre. Même dans la vie publique, où se manifeste le plus son originalité, il se garde d’accomplir des gestes provocateurs ou de proférer des paroles intentionnellement choquantes. Le révolutionnaire aime la vie, les hommes, l’activité collective. Comment pourrait donc devenir révolutionnaire celui qui adopte le principe selon lequel les hommes sont « comme une race hypocrite de crocodiles » ? Le révolutionnaire ne se contente pas d’aimer la vie, il s’efforce en outre de la connaître. Le savoir s’impose comme une condition de son pouvoir. Il se méfie des impulsions immédiates, des sentiments incontrôlés. Il s’oblige à voir le monde tel qu’il est, il ne se laisse pas aller à l’impatience » (p. 155). Et du reste la révolte ne s’oppose-t-elle pas « souvent totalement à la révolution » (p. 153) ? «
→ « On ne peut commander à l’histoire qu’en lui obéissant » — Ce n’est pas le changement historique que Hegel condamne, comme on le voit ; ni même le désir de ce changement, mais les prétentions de l’individualisme et son ignorance des lois de l’histoire. Il ne hait pas les véritables révolutionnaires » (p. 157) : « La « réconciliation » hégélienne comporte cette reconnaissance de la spécificité de l’histoire » (p. 157). Marx et Engels ne diront pas autre chose : « La négation efficace, dans l’histoire, c’est la négation intérieure, la négation dialectique, qui se dépasse dans sa propre négation, la négation de la négation « dont la loi — comme le dit Engels — a été formulée avec rigueur pour la première fois par Hegel » (p. 158) « Impossible, pour un révolutionnaire, selon Marx, de se trouver « en désaccord avec le monde », de le « dénigrer hargneusement », de préférer des « opinions » à la réalité, et de se laisser égarer par un idéal « subjectif ». Un semblable souci de saisie authentique du réel, une même méfiance à l’égard des appréciations subjectives, une égale volonté de rendre compte de l’histoire, non par les impulsions aberrantes qu’elle peut recevoir d’individus exceptionnels, mais par un mouvement autonome, tout cela se trouvait déjà chez Hegel, dès l’époque de ses travaux sur l’histoire interne du christianisme » (p. 160).
→ « Chacun veut et croit être meilleur que ce monde qui est le sien. Celui qui est meilleur exprime seulement ce monde mieux que ne le font les autres » (p. 162) — « Marx insiste à maintes reprises sur l’idée que le communisme ne consiste pas en un « idéal » extérieur au réel, en un type de société imaginé par quelques hommes qui en souhaiteraient l’instauration, afin que tout aille bien. Il déclare nettement : « Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses actuellement existantes ». Une telle caractéristique implique que le révolutionnaire est avant tout l’homme qui comprend le monde réel, et y discerne les germes d’un état futur. Il ne s’agit donc pas pour le révolutionnaire d’inventer un monde meilleur, mais de découvrir la dialectique immanente à ce monde-ci, et donc de saisir et d’exprimer véridiquement le présent. » (p. 162) L’erreur de Hegel consiste, selon Marx, non pas à avoir voulu comprendre son temps, mais à ne l’avoir en fait pas parfaitement compris. « Et ainsi Marx peut-il en quelque s »orte dresser Hegel contre Hegel lui-même : « La critique philosophique véritable ne montre pas seulement qu’il existe des contradictions dans la constitution politique actuelle, mais elle les explique, elle comprend leur genèse, leur nécessité. Elle les saisit dans leur signification propre. Mais cette saisie ne consiste pas, comme le croit Hegel, dans le fait de retrouver partout les déterminations du concept logique, mais dans le fait de saisir la logique propre de l’objet propre » » (Critique de la philosophie du droit de Hegel, MEGA). (p. 163).
→ « Qui accepterait d’expliquer l’action et l’œuvre de César par les seules intentions du grand homme, même si elles ont joué un rôle ? » (pp. 194-195) — « Les causes de [la] violence ne relèvent pas d’une « psychologie » des individus ou des peuples, soi-disant querelleurs, mais des conditions de leur existence, de l’articulation des formes sociales, animées par un « Esprit » dont ils ne sont que le support » (p. 193). Il faudra attendre Marx pour obtenir une analyse positive de rapports sociaux qui sont effectivement noués par des êtres concrets et actifs, mais qui, acquérant une surprenante autonomie (Verselbständigung), deviennent pour eux « comme des lois naturelles toutes-puissantes, expression d’une domination fatale, et qui se manifestent à eux sous l’aspect d’une nécessité aveugle » (Le Capital, III) (p. 194). « Les peuples renversent la tyrannie parce qu’elle serait abominable, vile, etc. — en fait, uniquement parce qu’elle est devenue inutile » (pp. 196-197) dira Hegel dans Realphilosophie. « Il faut accepter l’alternative : ou bien renoncer à l’explication historique, et se contenter de raconter des histoires — qui peuvent offrir de l’intérêt — , ou bien chercher l’explication dans l’histoire elle-même, et adopter une méthode qui retrouve le mouvement de la chose, non sans peine. Sur ce point, Marx continue Hegel. Hegel est le premier, dit Engels, qui soit parti de ce principe, et qui, armé d’une telle méthode, ait soutenu la thèse d’une connexion des événements, qui leur fût immanente, sans rien renier de leur diversité et de leurs soubresauts. Engels souligne que dans le système de Hegel, « pour la première fois — et c’est son grand mérite — la totalité du monde naturel, historique et spirituel est représentée comme un processus, c’est-à-dire comme comprise dans un mouvement, un changement, une transformation et un développement incessants, — et la tentative est faite de démontrer la connexion interne dans ce mouvement et dans ce développement ». Non seulement Hegel a postulé cette connexion interne, et l’action réciproque de ses moments analysables — l’unité organique d’une diversité — , mais il a aussi élaboré une logique nouvelle capable de nous en ouvrir l’accès. Non seulement il fournit le processus, mais aussi son mode d’emploi, la logique du processus, la dialectique » (p. 206).
→ « La dialectique subit, dans l’emploi qu’en fait Hegel, une sorte de mystification, mais il n’en reste pas moins vrai, Marx tient à nous l’assurer, que c’est lui, Hegel, qui « le premier en a exposé les formes générales de mouvement d’une manière ample et consciente » » (p. 207). Une telle conception de l’histoire comme processus, suppose que les apparences historiques sont liées à l’essence qui, justement, apparaît en elles disloquée et masquée, mais selon un mécanisme de dislocation et de camouflage qui peut être lui-même dévoilé. Pour que la réalité profonde soit décelée à partir de ses manifestations, il faut qu’elle ait atteint objectivement un certain degré de distinction, de détermination, que la manifestation reflète à sa manière. L’essence du travail salarié ne se dévoile que lorsque celui-ci a atteint une forme achevée, dans un stade avancé du capitalisme. En conséquence, une saisie erronée et parcellaire des apparences annonce historiquement la connaissance scientifique de la réalité » (pp. 207-208). Donc, certes, « le marxisme n’est pas l’hégélianisme, mais Marx et Engels n’ont pas renié Hegel. Ils ne l’ont pas traité comme un « chien crevé », à la manière des critiques grincheux et incompréhensifs qui s’en prenaient à eux en même temps qu’à lui. Ils ont respecté comme un maître, dont ils avaient beaucoup appris, Hegel, « ce type colossal », « à qui nous devons tant », comme Engels aime à le dire » (p. 209).
→ On peut évidemment lire utilement le Capital sans connaître Hegel. Mais pour bien saisir la méthode qui est mise en œuvre dans cet ouvrage, il faut avoir assimilé la dialectique hégélienne. Lénine le constatera : « Aphorisme : on ne peut parfaitement comprendre le Capital de Marx et en particulier son premier chapitre sans avoir étudié à fond et compris toute la logique de Hegel. Donc pas un marxiste n’a compris Marx un demi-siècle après lui ! » (Cahiers philosophiques, p. 149) (p. 210).
→ Préhistoire — « Comment se présenterait, par contraste, une dialectique consciente et éclairée ? C’est celle qui, par exemple, selon Marx, régira l’activité collective des hommes lorsque ceux-ci se seront élevés du règne de la nécessité aveugle au règne de la liberté. Non seulement ils détourneront toujours plus efficacement à leur profit la nécessité naturelle, mais, bien plus, ils se créeront eux-mêmes librement et deviendront les véritables auteurs de leur propre socialisation : celle-ci ne leur sera plus « octroyée » par la nature, comme dit Engels ! » (p. 217) « Dans une société de type traditionnel, l’activité technique s’organise autour de l’individu, ou du groupe, ou de la classe sociale. Dans une société sans classes, c’est l’humanité tout entière qui, selon Marx, agira génériquement et deviendra ainsi le sujet de sa propre socialisation, faisant l’économie des crises sociales et des révolutions. Mais alors elle déclenchera une dialectique sociale sans antagonismes brutaux, sans crises et sans révolutions : à ces dernières se substitueront des processus mentaux prospectifs, d’invention et de choix » (p. 217)
De l’aliénation à la rupture — « Les prolétaires sont exploités par un capital qu’ils produisent eux-mêmes dans certaines conditions. Ce capital est leur œuvre, et pourtant il se dresse devant eux comme une puissance qui leur est étrangère (fremd), une puissance opposée à certaines de leurs fins conscientes, une force hostile dont les effets sont d’abord, pour eux, aussi mal connus et aussi incontrôlables qu’un phénomène naturel » (p. 226). Jusqu'à ce que la « nécessité de la séparation, de la rupture, de la contradiction entre le travail et la propriété (il faut entendre ici la propriété des conditions de production) » s'impose : « la forme extrême de cette rupture, dans laquelle les forces productives du travail social sont développées de la façon la plus puissante, c’est le capital. C’est seulement sur la base matérielle qu’il crée, et au moyen des révolutions par lesquelles passe la classe ouvrière et toute la société dans le processus de cette création, que peut être rétablie l’unité originaire » (p. 227).
→ Réflexion étrange de Breton sur le rêve prothétique — « Freud se trompe encore très certainement en concluant à la non-existence du rêve prothétique — je veux parler du rêve engageant l’avenir immédiat —, tenir exclusivement le rêve pour révélateur du passé étant nier la valeur du mouvement. » (111) « Les dernières lignes de La Science des rêves, p. 608, sont sur ce point très catégoriques: « Le rêve, enfin, peut-il révéler l’avenir ? Il n’en peut être question. […] Car c’est du passé qu’il provient. » Pour Breton, adepte de la dialectique hégélienne et marxiste, ce point de vue est inacceptable. Le monde doit être considéré comme un ensemble de processus dont la grande loi est le mouvement perpétuel, l’incessant devenir (voir Engels, Ludwig Feuerbach […], chap. II, p. 17). Le rêve participe de ce même mouvement. » Je ne comprends pas ce qu'il entend par là.
→ Méta-physique concrète — Je me prends à lire et relire ce passage de L'homme sans qualité : « Au commencement, il y avait encore beaucoup parlé de son amour et de toutes les pensées qu’il lui inspirait, mais le paysage de plus en plus en prit la place. Le matin, le soleil éveillait Ulrich et quand les pêcheurs étaient en mer, les femmes et les enfants gardant les maisons, il semblait qu’ils fussent, lui et un âne broutant les buissons et les collines rocheuses qui séparaient les deux petites localités de l’île, les uniques animaux supérieurs qu’il y eût sur cet aventureux avant-poste de la terre. Il imitait son compagnon et montait sur l’une des collines ou s’étendait sur le rivage dans la société de la mer, de la roche et du ciel. Il n’est pas prétentieux de parler ainsi, car les différences de taille s’effaçaient comme s’effaçaient d’ailleurs, dans ce compagnonnage, les différences entre l’esprit, la nature animale et la nature inanimée, comme toute espèce de différence entre les choses se réduisait. Pour garder tout notre sang-froid, disons que ces différences sans doute ne s’effaçaient ni ne se réduisaient, mais que leur signification se détachait d’elles on n’était plus soumis à aucune des séparations qui caractérisent l’humanité », exactement comme l’ont décrit autrefois, envahis par l’amour mystique, ces croyants dont le jeune lieutenant de cavalerie ignorait encore jusqu’à l’existence. Il ne réfléchissait d’ailleurs pas à ces phénomènes (comme d’ordinaire, à l’instar des chasseurs sur la piste du gibier, on poursuit ses observations à la trace et réfléchit derrière elles), il ne s’en apercevait peut-être même pas, mais il les absorbait. Il s’abîmait dans le paysage, encore qu’on eût pu tout aussi bien dire qu’il était étrangement porté par lui, et quand le monde franchissait le seuil de ses yeux, le sens du monde, de l’intérieur de lui-même, battait sur ses bords en vagues silencieuses. Il était tombé dans le cœur du monde ; de lui à sa très lointaine bien-aimée, la distance était la même que jusqu’à l’arbre le plus proche; une sorte d’intériorité unissait les êtres et supprimait l’espace, comme, dans les rêves, deux êtres peuvent se traverser sans se confondre, et cette intimité transformait tous leurs rapports. Mais, pour le reste, cet état n’avait rien de commun avec le rêve. Il était clair et débordait de claires pensées; simplement, nulle cause, nul but, nul désir physique n’y agissait; toutes choses s’y éployaient en cercles toujours renouvelés, comme quand un jet d’eau tombe inépuisablement dans une vasque. C’était cela même qu’Ulrich décrivait dans ses lettres, et rien d’autre. Une transformation complète de la vie ; tout ce qui dépendait de cette forme nouvelle, retiré du foyer ordinaire de l’attention, avait perdu la netteté de ses contours ; vu ainsi, tout était plutôt légèrement dispersé et brouillé ; mais il était évident que d’autres foyers restituaient à toutes choses une sûreté et une clarté délicates. Car tous les problèmes et tous les incidents de la vie prenaient une douceur, une tendresse, une paix incomparables, et en même temps un sens entièrement différent de l’ancien. Qu’un scarabée, par exemple, passât sur la main de l’homme méditant, ce n’était pas là une approche, un passage, un éloignement, ce n’était pas un scarabée et un homme, mais un événement qui touchait indescriptiblement le cœur, même pas un événement, bien cela advint, mais un état. Grâce à ces silencieuses expériences, tout ce qui fait la vie ordinaire prenait une signification bouleversante, en quelque circonstance que ce fût. » (L'Homme sans qualités, pp. 148-149)
→ Gueorgui Efron : « Un journal, parce que j’éprouve le besoin impérieux de donner un sens à mon existence, et de comprendre le non-sens de certains événements », « car ce que je possède de mieux, c’est ma vie ». Un exercice d’introspection et de distanciation pour « regarder le monde en face et non pas obliquement ». Pour « garder une apparence humaine, de corps et d’esprit, dans le gigantesque chaos collectif » (Journal (1939‑1943).
→ Barricades — « Une simple feuille de papier – le papier journal d’un quotidien tel que Il Manifesto, par exemple –, une simple page – l’une des « Thèses sur le concept d’histoire » de Walter Benjamin, par exemple – peuvent nous offrir de véritables barricades contre ce qui, chaque jour, tente de nous asservir. » Didi-Huberman relis à ce propos la préface de Barthélemy Amengual aux Mémoires d’Eisenstein : « La grande loi de l’invention est l’association, la dérive, le fantasme, orientés par la volonté tenace, l’obsession de donner une solution concrète à un problème concret. Toute création est en définitive un collage, un montage, pourvu que l’habite un objectif unique : dans une barricade aussi les choses les plus hétéroclites se mêlent, « fragments et détails de toutes sortes », mais la résolution des combattants qui l’ont édifiée lui confère l’unité d’une arme défensive. » « C’est comme si l’œuvre en tant que montage – fait de multiples choses hétérogènes, de multiples bouts insécables, de multiples monades – n’affirmait sa nature composite, impure, complexe, que pour en revenir à un nouveau genre de simplicité, une monade d’ordre supérieur : simple geste, simple chose, barricade (chose et geste à la fois). Telle serait la « résolution des combattants » quand les combattants sont des poètes : mettre en jeu tout ce qui est possible (complexité) pour construire une barricade (simplicité). Faire servir toute complexité à la simplicité d’une chose et d’un geste, par exemple le geste de stopper la répression de nos imaginations et la police des idées. » (Didi-Huberman, 20 novembre 2011. Aperçues)
→ De la critique de l'image — « Le problème que pose l’image à toute tentative de « lecture discriminante », c’est que lorsque vous tirez un seul fil, la pelote entière vient vers vous au risque de vous sauter à la figure. L’image appelle le sensible, mais le sensible implique le corps, le corps s’agite de gestes, les gestes véhiculent des émotions, les émotions ne vont pas sans inconscient, et l’inconscient lui-même suppose un nœud de temps psychiques, de sorte que c’est toute la modélisation du temps et de l’histoire elle-même, y compris politique, qu’une seule image peut remettre en jeu ou en question. » (2 mai 2016, Didi-Huberman, 5 mai 2016. Aperçues)
→ La juste intuition de Warburg — Pour accéder à la « contre-pensée », « il faut quitter le domaine professionnel des idées. Il faut, pour constituer une esthétique qui en vaille la peine, savoir franchir les frontières de ce qu’on appelle communément l’histoire de la philosophie. Il faut, symétriquement, outrepasser les limites convenues de ce qu’on appelle l’histoire de la peinture : sortir du musée, interroger la rue, retourner à la cuisine – à l’atelier – des artistes, quitter la bibliothèque humaniste et se mêler à la foule des fêtes florentines, celles du Maggio par exemple. Alors, on comprend qu’une esthétique digne de ce nom ne puisse être qu’anthropologique. La danse des trois Grâces, sur le tableau de Botticelli, se trouve elle-même dans la position dialectique de médiatiser une pratique des concepts (dans un vieux livre de Sénèque revisité par les humanistes) et une pratique des gestes (dans un jeune corps de Florentine pratiquant la danse, avec deux amies, pour les fêtes de printemps). (Georges Didi-Huberman. Aperçues, 2 octobre 2002)
→ Hyperdialectique — « Dire dialectique, ce n’était donc pas formuler une ambition dogmatique de quelque nature que ce fût, c’était seulement une certaine façon d’observer les choses, et d’emboîter le pas de quelques écrivains, artistes ou essayistes – Georges Bataille, Walter Benjamin ou Carl Einstein, Raoul Hausmann ou S. M. Eisenstein – qui se tenaient plus près d’une pensée du sensible que d’une raison générale à fournir pour que s’organise la pensée du monde. » « Je viens de trouver, en reparcourant Le Visible et l’Invisible, l’ultime texte de Maurice Merleau-Ponty, quelque chose qui pourrait bien rendre compte de cette distinction à faire dans l’usage de la dialectique : « Il n’est de bonne dialectique que celle qui se critique elle-même et se dépasse comme énoncé séparé ; il n’est de bonne dialectique que l’hyperdialectique. La mauvaise dialectique est celle qui ne veut pas perdre son âme pour la sauver, qui veut être dialectique immédiatement, s’autonomise, et aboutit au cynisme, au formalisme, pour avoir éludé son propre double sens. Ce que nous appelons hyperdialectique est une pensée qui, au contraire, est capable de vérité, parce qu’elle envisage sans restriction la pluralité des rapports et ce qu’on a appelé l’ambiguïté. La mauvaise dialectique est celle qui croit recomposer l’être par une pensée thétique, par un assemblage d’énoncés, par thèse, antithèse et synthèse ; la bonne dialectique est celle qui est consciente de ceci que toute thèse est une idéalisation, que l’Être n’est pas fait d’idéalisations ou de choses dites, comme le croyait la vieille logique, mais d’ensembles liés où la signification n’est jamais qu’une tendance, où l’inertie du contenu ne permet jamais de définir un terme comme positif, un autre terme comme négatif, et encore moins un troisième terme comme suppression absolue de celui-ci par lui-même. Le point à noter est celui-ci : que la dialectique sans synthèse, dont nous parlons, n’est pas pour autant le scepticisme, le relativisme vulgaire, ou le règne de l’ineffable. [...] Dans la pensée et dans l’histoire, comme dans la vie, nous ne connaissons de dépassements que concrets, partiels, encombrés de survivances, grevés de déficits. » (23 septembre 2012) Et relatifs ?
→ « Regarder, cela veut justement dire prendre son temps. » (Georges Didi-Huberman. Aperçues, 5 mai 2012)
→ De l'inconvénient de ne pas regarder assez — « Au début de Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss raconte, avec son habituelle honnêteté d’observation, que son propre regard de voyageur exotique est toujours compliqué par un conflit : entre un sentiment de la perte dirigé vers le passé (tout ce qu’il sait ne pas voir parce que cela a déjà disparu) et une fatalité de la perte inhérente au présent lui-même (tout ce qu’il sait ne pas voir parce qu’il ne sait pas encore le regarder). Sa conclusion est aussi juste que tragique, puisqu’elle apparente l’apercevoir au double mouvement d’une blessure et d’un désir : « En fin de compte, je suis prisonnier d’une alternative : tantôt voyageur ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont tout ou presque lui échappait – pire encore inspirait raillerie et dégoût ; tantôt voyageur moderne courant après les vestiges d’une réalité disparue. Sur ces deux tableaux, je perds, et plus qu’il ne semble : car moi qui gémis devant des ombres, ne suis-je pas imperméable au vrai spectacle qui prend forme en cet instant, mais pour l’observation duquel mon degré d’humanité manque encore du sens requis ? Dans quelques centaines d’années, en ce même lieu, un autre voyageur, aussi désespéré que moi, pleurera la disparition de ce que j’aurais pu voir et qui m’a échappé. Victime d’une double infirmité, tout ce que j’aperçois me blesse, et je me reproche sans relâche de ne pas regarder assez. » (Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Librairie Plon, 1955 [éd. 1984], p. 43.) (Georges Didi-Huberman. Aperçues, 2 novembre 2012)